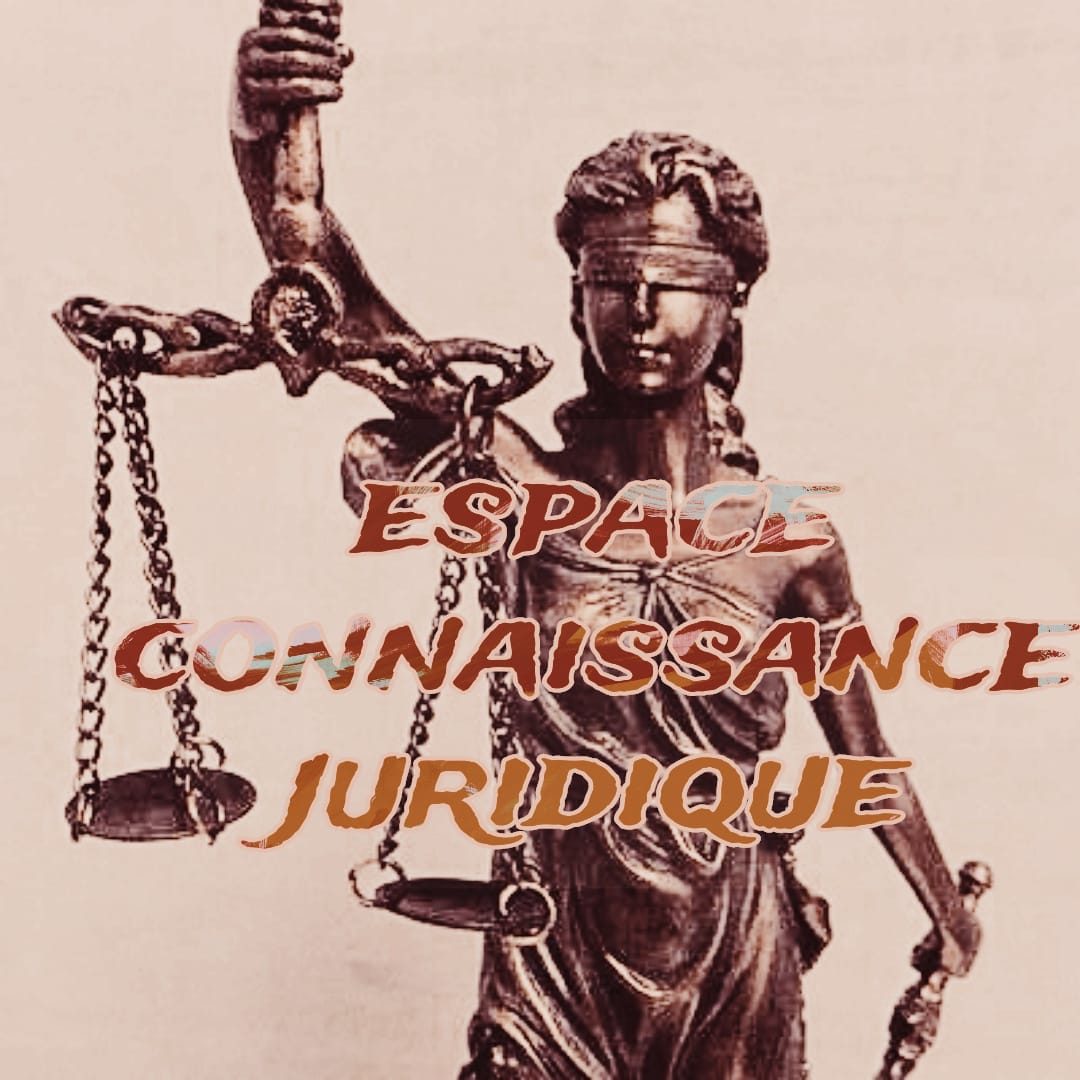levier de développement ?
Souria OULAD ABDELOUASSAA
Droit Comparé, Développement Durable et
Economie Appliquée Entrepreneuriat et Développement Local
- Cadre conceptuel
Depuis Adam Smith, la notion de la richesse et sa mesure suscite l’intérêt de nombreux auteurs et chercheurs. Ces dernières années, cette notion à montrer ces limites pour évaluer le développement des Etats. Aujourd’hui, elles sont dans la contrainte de réaliser en plus de la richesse, un progrès social accompagné du développement humain durable.
En effet, le concept du «Développement Humain Durable» est apparu pour la première fois en 1951. Dans un rapport publié par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) sur l’état de l’environnement dans le monde dans le but d’une union entre l’économie et l’écologie. Ce rapport servira de base pour les recherches suivantes au Club de Rome, dans les années 1960-1970 qui portait sur des concepts écologiques de l’époque.
La notion de développement durable a connu son essor au milieu des années 80, avec la prise de conscience des organisations internationales des limites de certains modes de mesure de la richesse provoquant une dégradation de l’humanité. Ce nouveau modèle de développement prend en compte les contraintes économiques, sociales et environnementales. C’est-à-dire, «le développement du peuple, pour le peuple (présent et futur) et par le peuple. Chaque action entrepris par l’Homme doit être orientée pour son bien être».([12])
Quant au « Rapport Brundtland » de 1989, il a engendré l’organisation d’une conférence sur les thèmes d’environnement et de développement et a ouvert le chemin pour le Sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro, ce dernier, a soutenu la notion de développement durable et a présenté un programme d’actions concret pour son application au niveau local, national et international.
L’objectif de ce Sommet était de chercher comment faire face aux problèmes pressants posés par la protection de l’environnement et le développement socio-économique. A cette occasion, le Maroc avait adopté la Convention sur les Changements Climatiques et celle sur la Biodiversité, ainsi que les principes d’Actions 21. Développer des indicateurs capables de nous renvoyer une image fidèle de notre société, du point de vue économique, social, environnemental et celui de la gouvernance.
Le Sommet de la Terre de 1992, a bel et bien lancé une campagne du développement durable par un plan d’action adopté lors de ce sommet, appelé «agenda 21», en tant que programme pour le développement durable au 21 siècle, ainsi que les Conventions qui y ont vu le jour, ont été éminemment adoptée et intégrée par les pays signataire.
Les collectivités territoriales ont été reconnues comme acteurs essentiels de la mise en œuvre des politiques de développement durable. Des lois ont permis d’intégrer cet acteur dans des actions extérieures permettant la diffusion des concepts du développement durable. En outre, l’Agenda 21 est un processus de programme et d’action volontaire ayant pour ambition d’engager le territoire et ses habitants dans les finalités et les enjeux mondiaux du développement durable en intégrant des éléments de démarche et de méthode spécifiques.
Les finalités sont définies dans le cadre de référence national de l’Agenda 21 :
- la lutte contre le changement climatique;
- la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources;
- la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations;
- l’épanouissement des êtres humains et la qualité de vie;
- la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
L’Agenda 21 est basé sur le principe de la participation des acteurs du territoire, la transversalité des approches, l’organisation spécifique du pilotage, l’articulation des niveaux de territoires tout en respectant le principe de subsidiarité et enfin le suivi et l’évaluation partagés permettant son amélioration continue, en tant que processus destiné à évoluer en permanence.
L’action internationale des collectivités recouvre la coopération décentralisée (conventions entre une ou plusieurs collectivités territoriales et une ou plusieurs autorités locales étrangères dans un intérêt commun), l’action extérieure (rayonnement économique et culturel, aide humanitaire), l’action de solidarité internationale mise en œuvre par des ONG du territoire, la coopération interrégionale et transfrontalière.
- Coopération décentralisée: action internationale des collectivités locales
Selon la Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), “La coopération décentralisée est un partenariat solidaire entre collectivités locales étrangères. Elle vise essentiellement à favoriser la prospérité commune, consolider le développement local et la gouvernance des territoires. Elle renforce les capacités des autorités locales à assumer les compétences de la décentralisation croissante dans les différentes régions du monde”. ([13])
Les actions recoupent les champs de compétence des pouvoirs locaux: développement urbain; eau et assainissement; état civil; espaces verts; gestion des services… etc. Elle est mise en œuvre de différentes manières selon les pays: à travers une aide financière et/ou un échange d’expertise; directement par la collectivité territoriale et/ou un opérateur extérieur; en forme bilatérale et/ou à travers des réseaux de collectivités.”
La coopération décentralisée est née par le principe du jumelage des communes après la deuxième guerre mondiale. L’idée était de rapprocher les peuples, de créer de la proximité, de l’amitié, de tisser du lien afin d’éviter qu’un nouveau conflit ne se reproduise. L’essence du projet européen animait déjà ces jumelages qui étaient surtout franco-allemands. On peut parler d’un premier âge de la coopération décentralisée, essentiellement européenne, symbolique et franco-allemande.
Pendant les années de 1970, les jumelages changent de nature lorsque des communes s’engagent dans des actions concrètes de solidarité, avec l’accès à l’indépendance des pays africains et l’émergence du Tiers-Monde sur la scène internationale. Une nouvelle expression d’une solidarité Nord-Sud et des jumelages-coopération unissent des collectivités locales de pays “industrialisés” et de pays “en voie de développement” afin d’établir une nouvelle forme de coopération, privilégiant les rapports humains. Les jumelages-coopération associent donc le concept de la paix, celui du développement.
La littérature aujourd’hui en matière de coopération décentralisée est incomplète. Très peu d’étude et de travaux de chercheurs sont consacrés à la coopération décentralisée à l’échelle nationale comme à l’échelle internationale. Au jour d’aujourd’hui, et à l’heure de la régionalisation avancée, il n’y a pas encore une œuvre de chercheurs consacrée à ce domaine. Cette situation démontre et confirme l’absence au stade d’évaluation, d’un référentiel en matière de coopération décentralisée susceptible de constituer ou de servir de base.
Ceci dit, la coopération décentralisée n’est pas un fait récent et nouveau. Elle trouve son origine des jumelages entre les villes françaises et allemandes à la sortie de la seconde guerre mondiale et s’étendra aux pays de l’Est pour se s’internationaliser. Elle s’imposera dès lors comme une forme de coopération au développement dans les pays du Sud.
La coopérati on décentralisée est devenue la nouvelle vision de l’aide publique au développement, ce nouveau contexte implique de nouveaux acteurs, dont les collectivités locales jouent un rôle incontournable dans sa contribution à l’action internationale, elle représente une opportunité pour les collectivités locales de s’imposer à l’échelle internationale, d’une part et d’autre part, c’est un enjeu de l’engagement en faveur du développement.
Par ailleurs, l’action extérieure des collectivités locales restent relativement large, au Maroc, il existe cinq types de coopération décentralisée.
- Coopération Interrégionale (de territoire à territoire) recouvre toute coopération entre des régions marocaines et des entités de taille régionale étrangères. Il s’agit de toute action menée avec l’étranger par la région ou la commune;
- Coopération avec les Organisations Internationales implique les organisations internationales dans le processus de la coopération comme intermédiaire entre les régions;
- Coopération Transfrontalière correspond aux relations de voisinage qui s’instaurent avec des partenaires directement au-delà des frontières terrestres ou maritimes;
- Coopération Sud-Sud signifie que «les pays pauvres aident les pays pauvres» et revêt une grande importance pour accélérer le développement de nombreux pays en voie de développement ([14]);
- Coopération Triangulaire est la tendance actuelle de la coopération décentralisée, il s’agit d’une hybridation de la coopération Sud-Sud et celle Nord-Sud.
Les formes mentionnées ci-dessus, suscitent un intérêt socio-économique majeur pour un développement humain durable.
- La lutte contre la pauvreté et les inégalités;
- Contribuer à une culture de paix et la lutte contre le racisme;
- Exporter et importer un savoir faire en matière de gestion;
- Renforcer et promouvoir la décentralisation;
- Renforcer les capacités, et trouver les ressources;
- Augmenter l’attractivité de la coopération décentralisée;
- Favoriser l’engagement des citoyens ;
- Renforcer l’expérience des fonctionnaires via la coopération décentralisée ;
- Favoriser les échanges entre les opérateurs économiques, entre universités et acteurs culturels.
2.2 Coopération décentralisée Franco-marocaine
Basée sur des liens étroit entre la France et le Maroc, la coopération décentralisée franco- marocaine se caractérise d’un ensemble de relations et de partenariats solide et durable et réponds aux principaux défis du Maroc, particulièrement en matière de stabilité économique et de cohésion social et accompagnement les grands politiques publiques définies par le gouvernement marocain: INDH, Plan Maroc Vert, Plan Solaire etc.
En 2011, un programme de soutien de la coopération décentralisée franco-marocaine a été lancé via la mise en œuvre d’un fond conjoint. Il est consacré au renforcent des capacités de maitrise d’ouvrage des collectivités locales marocaine dans six domaines :
- La planification et le développement local;
- Les services publics locaux;
- La valorisation des espaces publics et du patrimoine historique;
- L’environnement, le tourisme et l’aménagement du territoire;
- Le développement économique et l’insertion socio-économique;
- Le développement des terroirs.
La coopération franco-marocaine s’articule autour de trois composantes à savoir:
Le volet «appel à projet » destiné aux collectivités locales françaises et marocaines liées par un accord de coopération décentralisée, il accompagne les projets initiés par les deux partenaires, financé à hauteur de 60% du montant total du projet.
Le volet «bourse à projet » est ouvert pour les collectivités locales marocaines pour leurs permettre de formuler auprès de leurs homologue français une demande d’expertise ayant trait au développement de leurs capacités de maîtrise d’ouvrage.
Le volet «mutualisation des bonnes pratiques» est dédié à l’organisation de séminaires annuels franco-marocains pour l’échange et la capitalisation des actions de coopération décentralisée.
- Coopération décentralisée: levier de développement ?
La coopération décentralisée joue un rôle de déclencheur d’échange, qui permet de contribuer au développement des pays tout en offrant des opportunités aux entreprises et organismes des pays développés dans une logique gagnant-gagnant. Elle renforce la relation de réciprocité mutuelle, chaque partie souhaite donner et recevoir, et les intérêts économiques priment dans la réussite des partenariats.
- En France
- Des médiateurs individuels: des marocains installés en France, occupant des fonctions de cadres, interviennent à titre individuel comme médiateur pour démarrer une coopération ou agir dans un secteur donné, résidents marocains à l’étranger – RME
- Des raisons liées aux qualités géographiques et culturelles du Maroc :qualité géographique de la zone offrant des atouts touristiques, villes de renommée architecturale ou artistique. Les zones de coopération sont les régions les plus accessibles depuis la France.
- Des raisons liées à des facteurs personnels :”familiarité d’élus” avec le Maroc, affinités professionnelles, nostalgies diverses ce qui fait le côté parfois “un peu passionnel” des coopérations décentralisées franco-marocaines.
- Des raisons liées au facteur langue: La pratique de la langue française dans le pays facilite les contacts avec les autorités, les acteurs privés, les associatifs, les responsables d’institutions sociales, économiques…
Des raisons liées aux évolutions politiques et économiques du pays: politique de décentralisation, multipartisme, stabilité politique, adoption d’un système de libre entreprise qui manifeste son ouverture à l’international, le Maroc étant un pays-chantier dont le développement économique pouvant offrir des opportunités pour les entreprises françaises. La récente admission du Maroc comme pays à statut particulier associé à l’Union Européenne lui confère un statut avancé qui devrait permettre de l’intégrer progressivement dans les politiques de l’Union et d’approfondir les accords de libre- échange. Aux termes de cet accord, le Maroc est devenu moins qu’un membre, mais plus qu’un partenaire de l’Union Européenne. Les Régions françaises ajoutent à ce critère la facilité de relations avec les régions marocaines dont les compétences et le mode de fonctionnement sont proches des leurs.
- Des raisons de politique internationale: Des facteurs strictement politiques sont à considérer, liées à la position particulière du Maroc dans le monde arabe, afin de pouvoir éviter une fracture entre le Nord et le Sud de la Méditerranée: l’UE s’élargissant vers l’est de l’Europe, les pays méditerranéens sont devenus des pays de voisinage-sud (syndrome sécuritaire!) avec lesquels des relations économiques, culturelles, de tourisme, et plus généralement d’attraction deviennent très importantes.
- La pression du facteur sécuritaire lié à l’immigration clandestine, l’ambition européenne de construire et d’assurer une meilleure compréhension entre les deux rives de la Méditerranée, fait que la coopération avec le Maroc revêt de plus en plus une dimension démonstrative pour d’autres coopérations décentralisées.
Les collectivités françaises pensent quant à elles leur coopération comme:
- Un moyen de soutenir la décentralisation au Maroc et saisissent les opportunités d’actions qui vont dans ce sens.
- Un moyen de proposer un savoir – faire” pour la mise en place et la gestion des services publics locaux.
- Au Maroc
Un moyen de bénéficier de l’expérience de collectivités françaises ayant une longue histoire;
- Une opportunité de réaliser des projets concrets, visibles et directement utiles aux habitants dans des domaines divers: échanges entre artistes, aménagement urbain, environnement, dynamisation économique…
- Des possibilités d’accès à des financements pour réaliser des infrastructures et équipements nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des habitants, soit directement sur financement de leur collectivité partenaire soit en bénéficiant de l’appui des “grands bailleurs de fonds” ;
- Une forme de reconnaissance par leurs citoyens et l’Etat marocain de leur capacité à gérer des programmes et une opportunité de consolider leurs relations internationales.
Cette dernière motivation concerne prioritairement les communes urbaines dont la notoriété dépasse les frontières du Maroc. En général, les collectivités marocaines attendent de la coopération décentralisée :
- Des projets concrets, visibles et directement utiles aux habitants,
- La possibilité d’accéder à des financements.
Par ailleurs, la coopération décentralisée peut être en mesure de soutenir plusieurs pistes pour dynamiser le tissu de petites et moyennes entreprises locales. Parmi ces pistes on peut noter:
- un soutien au partenariat industriel ou artisanal fondé sur l’échange de savoir-faire entre entreprise: savoir-faire technique mais aussi savoir-faire en gestion, en commercialisation, en évaluation des montants d’investissement à réaliser, en définition de profils de poste…,
- un soutien à la mise en place d’un “directoire économique” au sein de la collectivité partenaire,
A l’image de programmes menés dans d’autres pays, la coopération décentralisée peut prendre en charge la production d’études de préfaisabilité pour démarrer de petites entreprises valorisant des productions locales.
Lors des forums, conférence ou Sommet, les autorités publiques et les organisations internationales ne cessent d’annoncer que les actions de la coopération décentralisée à plusieurs niveaux constituent un vecteur de développement pour les pays partenaires, et surtout des deux territoires des collectivités locales en question. Dans ces discours, la coopération décentralisée est souvent vue comme un outil de développement à un but social plutôt qu’économique. Ceci dit, la finalité économique n’est perçue que comme une résultante indirecte de la coopération décentralisée. Alors qu’elle peut constituer un volet à part entière de l’échange.
L’histoire et le rapprochement de la France et du Maroc fait que leurs coopérations décentralisées jouirent d’une place très importante par rapport aux autres coopérations. Or, cette coopération à besoin dans un premier temps que ses acteurs en définissent des perspectives et en clarifient les approches. Dans un deuxième temps, la coopération franco- marocaine manque d’un système de références partagées qui la positionne parmi les différentes formes de coopération. Et enfin, cette coopération décentralisée à besoin de développer les relations de territoire à territoire, ainsi que la création des plateformes de concertation entre les collectivités locales et les acteurs du territoire.
La coopération en matière de développement local, de cohésion sociale, de gouvernance et de renforcement institutionnel dans la gestion locale, ainsi qu’en matière de culture d’innovation entre les deux pays. La coopération décentralisée permet aussi, la promotion du dialogue entre les peuples ainsi qu’un développement local des territoires ciblés par son impact comme outil de développement durable, d’une part et d’autre part, outil de développement économique et social, de même, un développement équilibré du territoire à différents échelles.
Dans le rapport «évaluation de la coopération franco-marocaine» publié en 2009. La coopération décentralisée manque d’un système de références partagées qui la positionnent parmi les différentes formes de coopération. D’une manière générale, les collectivités locales françaises sont plus sensibles aux enjeux et opportunités d’affaires pour les entreprises françaises que représentent et la décentralisation au Maroc et la coopération décentralisée franco-marocainee ([15]).
[12]http://lewebpedagogique.com/unicef-education
[13] Cités et Gouvernements Locaux Unis
[14] SHA ZUKANG, le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les Affaires Economiques et Sociales, Forum de coopération de développement de juillet 2008 à New York
[15] Rapport «etude sur le renforcement de la capacité de gestion des collectivités locales» Ministère de l’Intérieur, Avril 2006.